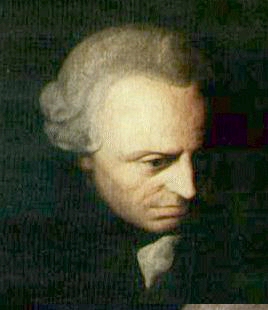C'était il y a longtemps, lorsque le ciel était trop bas. Il était si bas qu'il n'y avait pas de place pour les nuages. Il était si bas que les arbres ne pouvaient pas pousser. Il était si bas que les oiseaux ne pouvaient pas voler. S'ils essayaient, ils se cognaient aux arbres et aux nuages.
Mais ce qui était plus pénible encore, c'était que les hommes adultes ne pouvaient pas se tenir debout, bien droits comme leurs corps le leur demandaient. Ils devaient marcher tout penchés, en regardant leurs pieds et ne voyaient pas où ils allaient.
Les enfants ne connaissaient pas ce problème. Ils étaient petits, ils pouvaient se lever aussi droits qu'ils le souhaitaient. Ils ne marchaient pas en regardant leurs pieds et pouvaient voir où ils allaient.
Ils savaient par contre qu'un jour, ils deviendraient des adultes et qu'ils devraient marcher tout penchés en regardant leurs pieds à moins que quelque chose ne se passe. Un soir, tous les enfants se réunissent et décident de relever le ciel. Les quelques adultes qui les écoutent rient sous cape mais soudain, ils voient les enfants lever de longs poteaux vers le ciel. Un, deux, trois, quatre... Un cri énorme retentit UUU-UHHHH ! Mais rien ne se passe.
Le ciel reste comme il a toujours été. Les arbres ne peuvent toujours pas grandir. Les oiseaux ne peuvent toujours pas voler. Il n'y a toujours pas de place pour les nuages et lesadultes marchent toujours courbés en regardant leurs piedssans voir où ils vont.
Le lendemain, les enfants recommencent avec des poteaux plus longs. Un, deux, trois, quatre... Un cri énorme retentit UUU-UHHHH ! Mais rien ne se passe.
Le soir suivant, les enfants (qui sont persévérants) essayent encore. Ils prennent des poteaux encore plus longs. Un, deux, trois, quatre...Un cri énorme retentit UUU-UHHHH ! Mais rien ne se passe.
Le quatrième soir, ils ont trouvé de très, très, très longs poteaux, les plus longs qu'ils pouvaient trouver et ils se sont mis à compter. Un, deux, trois, quatre...Un cri énorme a retentit UUU-UHHHH ! Et le ciel s'est soulevé. Depuis ce jour, le ciel est à sa place.
Les arbres peuvent pousser, les oiseaux peuvent voler sans se heurter aux troncs et aux branches. Les nuages ont de la place pour aller et venir et les hommes peuvent se tenir droit en regardant le ciel. Mais le plus merveilleux c'est que lorsque le soleil s'est couché la nuit suivante et qu'il a commencé à faire sombre, le ciel troué par les poteaux des enfants s'est mis à scintiller. Dans chaque trou, il y avait une étoile.
La prochaine fois que vous regarderez le ciel, vous saurez que c'est grâce aux enfants que vous pouvez admirer un tel spectacle. Vous repenserez à cette histoire et vous saurez que c'était vrai.